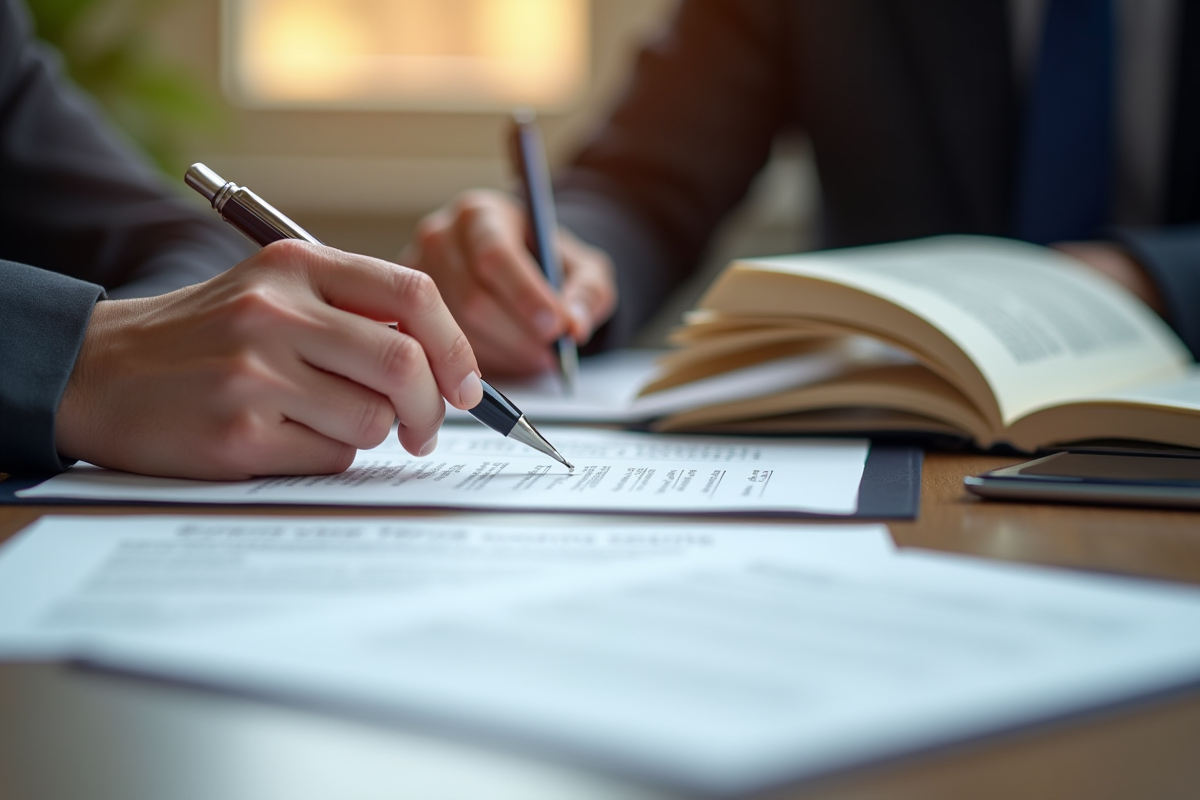La condamnation au paiement de frais par la partie perdante ne couvre pas toujours l’ensemble des dépenses réellement engagées par l’autre partie. Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation pour accorder une somme supplémentaire, distincte des frais remboursables d’office. Ce mécanisme, souvent invoqué mais parfois mal compris, répond à des règles précises et à des limites strictes.
Depuis 2020, la tentative de résolution amiable d’un litige est devenue une condition préalable obligatoire dans de nombreux cas, modifiant les stratégies procédurales. Certaines procédures imposent en plus la représentation par avocat, avec des conséquences directes sur la prise en charge des frais.
Frais de justice et dépens : comprendre les coûts d’une procédure judiciaire
Derrière chaque action devant un tribunal, une réalité s’impose : la procédure judiciaire s’accompagne toujours de dépenses, parfois visibles, parfois moins attendues. Le terme frais de justice recouvre l’ensemble des montants engagés pour faire reconnaître ses droits devant le juge. Mais tous ces frais ne se valent pas, ni en nature, ni en prise en charge.
Pour clarifier ce qui se cache derrière le mot dépens, il faut distinguer plusieurs catégories de frais :
- honoraires d’huissier,
- frais d’expertise,
- taxes diverses,
- émoluments de greffe.
Lorsque le juge prononce la condamnation aux dépens, il impose généralement à la partie perdante le remboursement de ces montants précis. Mais ce remboursement ne couvre pas tout : les honoraires d’avocat, poste souvent le plus conséquent, restent en principe à la charge du justiciable, sauf si le juge en décide autrement.
C’est là qu’intervient la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce mécanisme offre la possibilité d’obtenir, sous conditions, une indemnisation partielle des frais non compris dans les dépens, essentiellement les honoraires d’avocat. À chaque affaire, le tribunal statue en tenant compte de critères d’équité, de la nature du litige et de la situation financière de chacun. Le montant accordé n’est jamais automatique, il varie selon les circonstances.
La diversité des juridictions, qu’il s’agisse du tribunal judiciaire ou de la cour, entraîne parfois des pratiques différentes. Le code judiciaire impose de bien distinguer chaque poste de dépense, faute de quoi le justiciable risque de mauvaises surprises.
À quoi sert l’article 700 du Code de procédure civile ?
L’article 700 du code de procédure civile sert de correctif à la rigidité des frais judiciaires. Son objectif : permettre au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme compensatoire pour les frais non remboursés d’office, en particulier les honoraires d’avocat et autres dépenses annexes. Celui qui gagne ne doit pas, en principe, supporter seul le coût de sa défense.
Dans la pratique, le tribunal ou la cour statue uniquement si l’une des parties en fait la demande. Le montant attribué au titre de l’article 700 CPC dépend de l’appréciation du juge, qui évalue la situation au cas par cas. Cette disposition concerne toutes les procédures civiles, commerciales ou prud’homales, et s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises ou associations.
Concrètement, la demande se fait par écrit ou à l’audience, accompagnée des justificatifs des frais engagés. L’avocat précise le montant sollicité, mais rien n’oblige le juge à suivre ce chiffre. Ce dernier module la somme en fonction de la nature du litige, des ressources de chacun, et du contexte du dossier. Le système ne fait pas disparaître la règle des dépens : il s’y ajoute, offrant parfois une respiration bienvenue à celui qui a dû se défendre face à une procédure longue et coûteuse.
Comment le juge décide-t-il du remboursement des frais d’avocat ?
Décider qui paiera, et combien, relève d’une appréciation fine. Le juge ne se contente pas d’appliquer un barème : il étudie le dossier, les arguments de chaque camp, les justificatifs transmis. Son regard englobe la situation financière, mais aussi l’attitude procédurale de chacun.
Pour mieux comprendre les éléments qui entrent dans la balance, voici les principaux critères analysés par le tribunal :
- Ressources et charges : la capacité financière des parties pèse lourd dans la décision. Une grande entreprise et un particulier ne seront pas traités de la même façon.
- Nature et complexité du litige : une affaire simple n’appelle pas les mêmes frais qu’un dossier technique, long ou à forts enjeux.
- Frais réellement exposés : il faut prouver les montants engagés, par des factures, des conventions d’honoraires ou d’autres justificatifs.
La cour de cassation, notamment sa deuxième chambre civile, rappelle régulièrement que les juges doivent accorder une indemnité raisonnable, sans prendre l’obligation d’indemniser la totalité des honoraires d’avocat. La marge de manœuvre reste large, chaque dossier apporte son lot de spécificités, chaque décision cherche à préserver un certain équilibre.
Nouvelle obligation de tentative amiable et représentation obligatoire : ce qui change pour les justiciables
La réforme du décret du 11 décembre 2019 a redistribué les cartes de la procédure judiciaire en France. Avant même de pouvoir saisir le tribunal, chacun doit désormais prouver qu’il a tenté une résolution amiable du litige, sauf exceptions prévues par la loi. Derrière cette nouvelle étape se cache la volonté de fluidifier le fonctionnement des juridictions et d’encourager le dialogue, mais elle bouscule aussi les réflexes habituels de beaucoup de justiciables.
Cela implique l’intervention de nouveaux acteurs dans la phase préalable : médiateur, commissaire de justice… La préparation du dossier ne se limite plus à rassembler des pièces, il faut aussi prouver la tentative de règlement amiable. Un manquement à cette étape expose au risque de voir sa demande déclarée irrecevable dès le début de la procédure.
Parallèlement, la représentation obligatoire par un avocat est renforcée dans de nombreux contentieux civils. Cette nouvelle exigence ajoute une couche supplémentaire de complexité. Comprendre la chronologie des démarches, anticiper les coûts, savoir à quel moment faire appel à la médiation ou à un avocat, devient indispensable pour ne pas se perdre dans le jeu procédural.
Pour mieux saisir ces évolutions, voici ce qui a véritablement changé dans le parcours du justiciable :
- Tentative amiable obligatoire : désormais, impossible de passer directement devant le juge sans avoir tenté de résoudre le conflit en amont.
- Représentation par avocat : dans de nombreux cas, l’assistance d’un professionnel du droit s’impose pour accéder au tribunal.
- Justification de la démarche : le dossier de saisine doit comporter la preuve de la tentative amiable, sous peine de rejet.
Ce nouveau cadre reflète une volonté de responsabiliser les parties et d’encourager le dialogue avant l’ouverture d’un contentieux. Mais il réclame aussi une plus grande maîtrise des rouages procéduraux. Pour le justiciable, le chemin vers la justice n’a jamais été aussi balisé, à chacun d’en saisir les codes pour ne pas perdre pied dans la complexité croissante de la procédure.